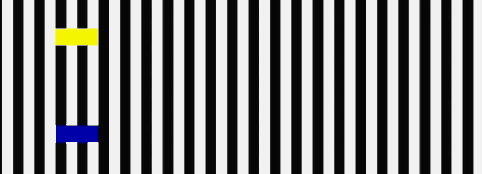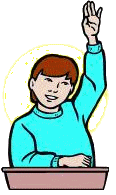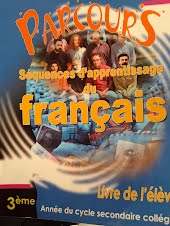-
Sans famille chapitre 1 première partie
Sans famille -première partie -chapitre 1
I - Au village
Je suis un enfant trouvé.
Mais, jusqu’à huit ans, j’ai cru que, comme tous les autres enfants, j’avais une mère, car, lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras en me berçant, que mes larmes s’arrêtaient de couler.
Jamais je ne me couchais dans mon lit sans qu’une femme vint m’embrasser, et, quand le vent de décembre collait la neige contre les vitres blanchies, elle me prenait les pieds entre ses deux mains et elle restait à me les réchauffer en me chantant une chanson, dont je retrouve encore dans ma mémoire l’air et quelques paroles.
Quand j’avais une querelle avec un de mes camarades, elle me faisait conter mes chagrins, et presque toujours elle trouvait de bonnes paroles pour me consoler ou me donner raison.
Par tout cela et par bien d’autres choses encore, par la façon dont elle me parlait, par la façon dont elle me regardait, par ses caresses, par la douceur qu’elle mettait dans ses gronderies, je croyais qu’elle était ma mère.
Voici comment j’appris qu’elle n’était que ma nourrice.
Mon village, ou, pour parler plus justement, le village où j’ai été élevé, car je n’ai pas eu de village à moi, pas de lieu de naissance, pas plus que je n’ai eu de père et de mère, le village enfin où j’ai passé mon enfance se nomme Chavanon ; c’est l’un des plus pauvres du centre de la France.
Cette pauvreté, il la doit non à l’apathie ou à la paresse de ses habitants, mais à sa situation même dans une contrée peu fertile. Le sol n’a pas de profondeur, et pour produire de bonnes récoltes il lui faudrait des engrais ou des amendements qui manquent dans le pays. Aussi ne rencontre-t-on (ou tout au moins ne rencontrait-on à l’époque dont je parle) que peu de champs cultivés.
C’est dans un repli de terrain, sur les bords d’un ruisseau qui va perdre ses eaux rapides dans un des affluents de la Loire, que se dresse la maison où j’ai passé mes premières années.
Jusqu’à huit ans, je n’avais jamais vu d’homme dans cette maison ; cependant ma mère n’était pas veuve, mais son mari, qui était tailleur de pierre, comme un grand nombre d’autres ouvriers de la contrée, travaillait à Paris, et il n’était pas revenu au pays depuis que j’étais en âge de voir ou de comprendre ce qui m’entourait. De temps en temps seulement, il envoyait de ses nouvelles par un de ses camarades qui rentrait au village.
« Mère Barberin, votre homme va bien ; il m’a chargé de vous dire que l’ouvrage marche fort, et de vous remettre l’argent que voilà ; voulez-vous compter ? »
Et c’était tout. Mère Barberin se contentait de ces nouvelles : son homme était en bonne santé ; l’ouvrage donnait ; il gagnait sa vie.
De ce que Barberin était resté si longtemps à Paris, il ne faut pas croire qu’il était en mauvaise amitié avec sa femme. La question de désaccord n’était pour rien dans cette absence.
Il demeurait à Paris parce que le travail l’y retenait ; voilà tout. Quand il serait vieux, il reviendrait vivre près de sa vieille femme, et avec l’argent qu’ils auraient amassé ils seraient à l’abri de la misère pour le temps où l’âge leur aurait enlevé la force et la santé.
Un jour de novembre, comme le soir tombait, un homme, que je ne connaissais pas, s’arrêta devant notre barrière. J’étais sur le seuil de la maison occupé à casser une bourrée. Sans pousser la barrière, mais en levant sa tête par-dessus en me regardant, l’homme me demanda si ce n’était pas là que demeurait la mère Barberin.
Je lui dis d’entrer.
Au bruit de nos voix, mère Barberin accourut et, au moment où il franchissait notre seuil, elle se trouva face à face avec lui.
« J’apporte des nouvelles de Paris », dit-il.
C’étaient là des paroles bien simples et qui déjà plus d’une fois avaient frappé nos oreilles ; mais le ton avec lequel elles furent prononcées ne ressemblait en rien à celui qui autrefois accompagnait les mots : « Votre homme va bien, l’ouvrage marche. »
« Ah ! mon Dieu ! s’écria mère Barberin en joignant les mains, un malheur est arrivé à Jérôme !
- Eh bien, oui, mais il ne faut pas vous rendre malade de peur ; votre homme a été blessé, voilà la vérité ; seulement il n’est pas mort. Pourtant il sera peut-être estropié. Pour le moment il est à l’hôpital. J’ai été son voisin de lit, et, comme je rentrais au pays, il m’a demandé de vous dire la chose en passant. »
Mère Barberin, qui voulait en savoir plus long, pria l’homme de rester à souper.
Il s’assit dans le coin de la cheminée et, tout en mangeant, il nous raconta comment le malheur était arrivé : Barberin avait été à moitié écrasé par des échafaudages qui s’étaient abattus, et comme on avait prouvé qu’il ne devait pas se trouver à la place où il avait été blessé, l’entrepreneur refusait de lui payer aucune indemnité.
« Pourtant, dit-il en terminant son récit, je lui ai donné le conseil de faire un procès à l’entrepreneur.
- Un procès, cela coûte gros.
- Oui, mais quand on le gagne ! »
Mère Barberin aurait voulu aller à Paris, mais c’était une terrible affaire qu’un voyage si long et si coûteux.
Le lendemain matin, nous descendîmes au village pour consulter le curé. Celui-ci ne voulut pas la laisser partir sans savoir avant si elle pouvait être utile à son mari. Il écrivit à l’aumônier de l’hôpital où Barberin était soigné, et, quelques jours après, il reçut une réponse, disant que mère Barberin ne devait pas se mettre en route, mais qu’elle devait envoyer une certaine somme d’argent à son mari, parce que celui-ci allait faire un procès à l’entrepreneur chez lequel il avait été blessé.
Les journées, les semaines s’écoulèrent, et de temps en temps il arriva des lettres qui toutes demandaient de nouveaux envois d’argent ; la dernière, plus pressante que les autres, disait que, s’il n’y avait plus d’argent, il fallait vendre la vache pour s’en procurer.
Ceux-là seuls qui ont vécu à la campagne avec les paysans savent ce qu’il y a de détresses et de douleurs dans ces trois mots : « vendre la vache ».
Pour le naturaliste, la vache est un animal ruminant ; pour le promeneur, c’est une bête qui fait bien dans le paysage lorsqu’elle lève au-dessus des herbes son mufle noir humide de rosée ; pour l’enfant des villes, c’est la source du café au lait et du fromage à la crème ; mais pour le paysan, c’est bien plus et mieux encore. Si pauvre qu’il puisse être et si nombreuse que soit sa famille, il est assuré de ne pas souffrir de la faim tant qu’il y a une vache dans son étable. Avec une longe ou même avec une simple hart nouée autour des cornes, un enfant promène la vache le long des chemins herbus, là où la pâture n’appartient à personne, et le soir la famille entière a du beurre dans sa soupe et du lait pour mouiller ses pommes de terre ; le père, la mère, les enfants, les grands comme les petits, tout le monde vit de la vache.
Nous vivions si bien de la nôtre, mère Barberin et moi, que jusqu’à ce moment je n’avais presque jamais manqué de viande. Mais ce n’était pas seulement notre nourrice qu’elle était, c’était encore notre camarade, notre amie, car il ne faut pas s’imaginer que la vache est une bête stupide, c’est au contraire un animal plein d’intelligence et de qualités morales d’autant plus développées qu’on les aura cultivées par l’éducation.
Nous caressions la nôtre, nous lui parlions, elle nous comprenait, et de son côté, avec ses grands yeux ronds pleins de douceur, elle savait très bien nous faire entendre ce qu’elle voulait ou ce qu’elle ressentait.
Enfin nous l’aimions et elle nous aimait, ce qui est tout dire.
Pourtant il fallut s’en séparer, car c’était seulement par « la vente de la vache » qu’on pouvait satisfaire Barberin.
Il vint un marchand à la maison et, après avoir bien examiné la Roussette, après avoir dit et répété cent fois qu’elle ne lui convenait pas du tout, que c’était une vache de pauvres gens qu’il ne pourrait pas revendre, qu’elle n’avait pas de lait, qu’elle faisait du mauvais beurre, il avait fini par dire qu’il voulait bien la prendre, mais seulement par bonté d’âme et pour obliger mère Barberin qui était une brave femme.
La pauvre Roussette, comme si elle comprenait ce qui se passait, avait refusé de sortir de son étable et elle s’était mise à meugler.
« Passe derrière et chasse-la, m’avait dit le marchand en me tendant le fouet qu’il portait passé autour de son cou.
- Pour ça non », avait dit mère Barberin.
Et, prenant la vache par la longe, elle lui avait parlé doucement.
« Allons, ma belle, viens, viens. »
Et Roussette n’avait plus résisté ; arrivé sur la route, le marchand l’avait attachée derrière sa voiture, et il avait bien fallu qu’elle suivît le cheval.
Nous étions rentrés dans la maison. Mais longtemps encore nous avions entendu ses beuglements.
Plus de lait, plus de beurre. Le matin un morceau de pain ; le soir des pommes de terre au sel.
Le mardi gras arriva justement peu de temps après la vente de Roussette ; l’année précédente, pour le mardi gras, mère Barberin m’avait fait un régal avec des crêpes et des beignets ; et j’en avais tant mangé, tant mangé, qu’elle en avait été tout heureuse.
Mais alors nous avions Roussette, qui nous avait donné le lait pour délayer la pâte et le beurre pour mettre dans la poêle.
Plus de Roussette, plus de lait, plus de beurre, plus de mardi gras ; c’était ce que je m’étais dit tristement.
Mais mère Barberin m’avait fait une surprise ; bien qu’elle ne fût pas emprunteuse, elle avait demandé une tasse de lait à l’une de nos voisines, un morceau de beurre à une autre, et, quand j’étais rentré, vers midi, je l’avais trouvée en train de verser de la farine dans un grand poêlon en terre.
« Qu’est-ce qu’on fait avec de la farine ? dit-elle en me regardant.
- Du pain.
- Et puis encore ?
- De la bouillie.
- Et puis encore ?
- Dame... Je ne sais pas.
- Si, tu sais bien.
Mais, comme tu es un bon petit garçon, tu n’oses pas le dire. Tu sais que c’est aujourd’hui mardi gras, le jour des crêpes et des beignets. Mais, comme tu sais aussi que nous n’avons ni beurre, ni lait, tu n’oses pas en parler. C’est vrai ça ?
- Oh ! mère Barberin.
- Donne-moi les oeufs, me dit-elle, et, pendant que je les casse, pèle les pommes. »
Pendant que je coupais les pommes en tranches, elle cassa les oeufs dans la farine et se mit à battre le tout, en versant dessus, de temps en temps, une cuillerée de lait.
Quand la pâte fut délayée, mère Barberin posa la terrine sur les cendres chaudes, et il n’y eut plus qu’à attendre le soir, car c’était à notre souper que nous devions manger les crêpes et les beignets.
« Casse de la bourrée, me dit-elle ; il nous faut un bon feu clair, sans fumée. »
Alors mère Barberin décrocha de la muraille la poêle à frire et la posa au-dessus de la flamme.
« Donne-moi le beurre. »
Elle en prit, au bout de son couteau, un morceau gros comme une petite noix, et le mit dans la poêle, où il fondit en grésillant.
Ah ! c’était vraiment une bonne odeur qui chatouillait d’autant plus agréablement notre palais que depuis longtemps nous ne l’avions pas respirée.
C’était aussi une joyeuse musique que celle produite par les grésillements et les sifflements du beurre.
Cependant, si attentif que je fusse à cette musique, il me sembla entendre un bruit de pas dans la cour.
Qui pouvait venir nous déranger à cette heure ? Une voisine sans doute, pour nous demander du feu.
Mais je ne m’arrêtai pas à cette idée, car mère Barberin, qui avait plongé la cuiller à pot dans la terrine, venait de faire couler dans la poêle une nappe de pâte blanche, et ce n’était pas le moment de se laisser aller aux distractions.
Un bâton heurta le seuil, puis aussitôt la porte s’ouvrit brusquement.
« Qui est là ? » demanda mère Barberin sans se retourner.
Un homme était entré, et la flamme qui l’avait éclairé en plein m’avait montré qu’il était vêtu d’une blouse blanche et qu’il tenait à la main un gros bâton.
« On fait donc la fête ici ? Ne vous gênez pas, dit-il d’un ton rude.
- Ah ! mon Dieu ! s’écria mère Barberin en posant vivement sa poêle à terre, c’est toi, Jérôme ? »
Puis me prenant par le bras elle me poussa vers l’homme qui s’était arrêté sur le seuil :
« C’est ton père. »
Conception ; Chaïrich Abdenbi-Tétouan
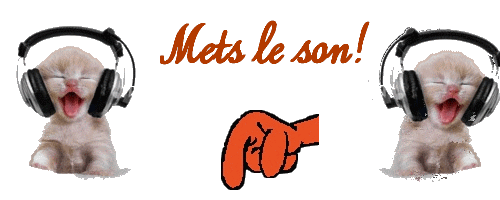
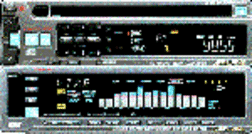




















 Lisez cet article très important.
Lisez cet article très important.